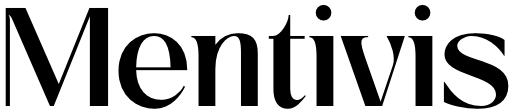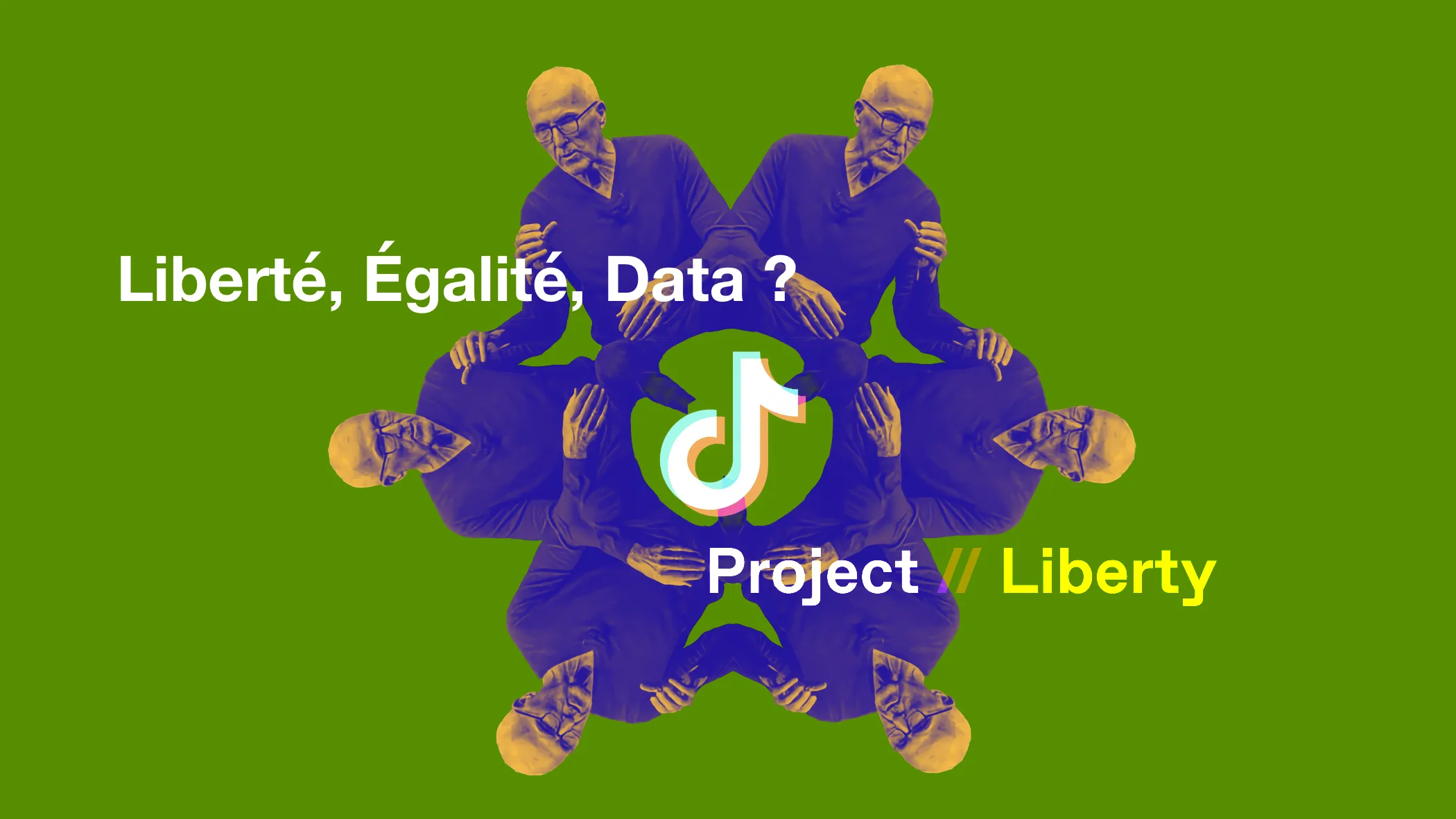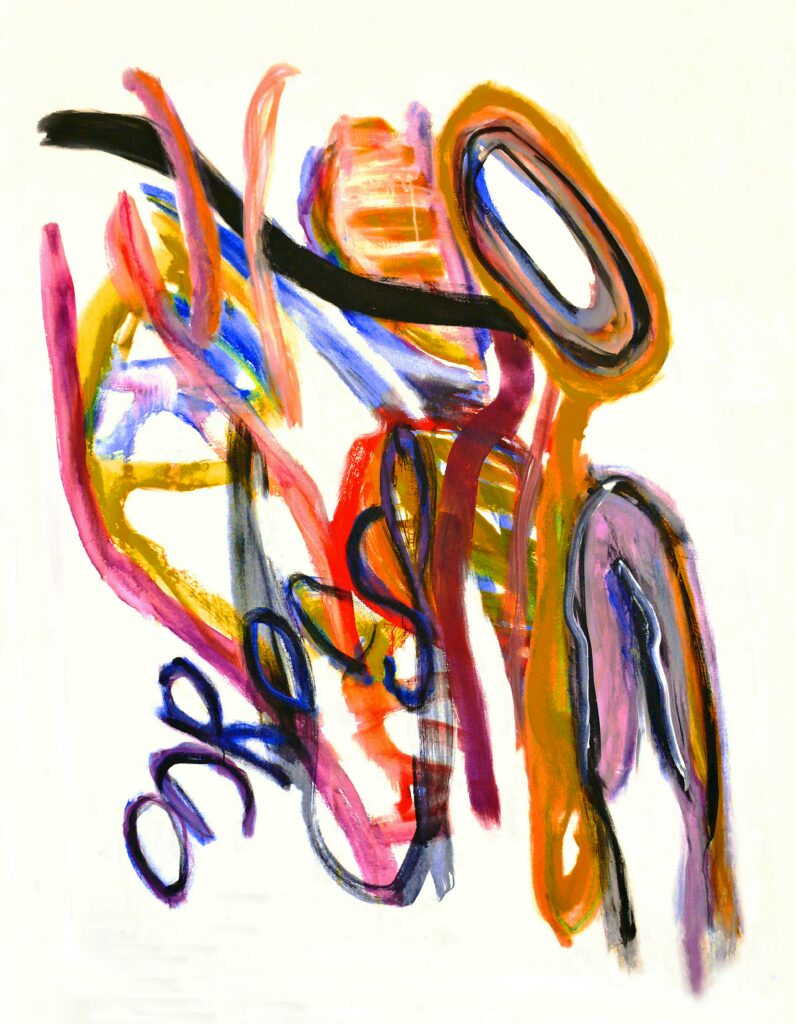Liberté, Égalité, Data ?
Projet Liberty : quand l’ambition de Frank McCourt redessine l’avenir de l’éducation numérique
Dans un monde numérique dominé par une poignée de géants technologiques, Frank McCourt, entrepreneur américain et propriétaire de l’Olympique de Marseille, trace les contours d’une alternative ambitieuse. Son Projet Liberty, doté d’un investissement initial de 100 millions de dollars, ne se contente pas de proposer une refonte technique d’internet : il porte une vision transformatrice pour l’éducation à l’ère numérique, avec des implications potentiellement révolutionnaires dans les salles de classe du monde entier.
Une alliance stratégique avec l’enseignement supérieur
Le choix de Sciences Po et de l’Université de Georgetown comme partenaires fondateurs de cette initiative n’est pas anodin. En s’associant à deux institutions académiques prestigieuses de part et d’autre de l’Atlantique, McCourt ancre délibérément sa vision technologique dans le monde de l’éducation et de la recherche. Les 25 millions de dollars alloués à Sciences Po sur dix ans financent actuellement huit projets de recherche mobilisant onze chercheurs autour de la thématique « Tech for the common good ».
« Ce partenariat constitue un pont inédit entre les spécialistes des sciences sociales et ceux des nouvelles technologies », explique un chercheur associé au projet qui souhaite rester anonyme. « Nous assistons à l’émergence d’un dialogue transdisciplinaire qui était jusqu’alors largement absent du développement technologique. »
Cette alliance académique témoigne d’une prise de conscience : la transformation numérique de nos sociétés ne peut être guidée uniquement par des considérations techniques ou commerciales, mais doit intégrer les perspectives des sciences humaines et sociales pour répondre aux défis éthiques, politiques et sociaux qu’elle soulève.
Repenser l’éducation numérique de fond en comble
L’approche interdisciplinaire promue par le Projet Liberty pourrait bouleverser les paradigmes éducatifs actuels. En plaçant l’éthique et la protection des données au cœur de sa vision, McCourt invite à repenser non seulement les outils numériques utilisés dans l’enseignement, mais également la manière dont nous concevons le rapport entre apprenants, données éducatives et plateformes numériques.
« Le modèle dominant actuel transforme les étudiants en produits dont les données d’apprentissage sont exploitées commercialement », analyse Dr. Mohamed Kossaï spécialiste des technologies éducatives et sciences économiques à de l’Université Paris-Dauphine, non affiliée au projet. « La vision de McCourt propose un renversement radical : rendre aux apprenants la propriété et le contrôle de leurs données éducatives. »
Cette approche décentralisée pourrait concrètement se traduire par des plateformes d’apprentissage où les parcours éducatifs ne seraient plus dictés par des algorithmes opaques optimisés pour l’engagement et la monétisation, mais par des choix pédagogiques transparents respectant l’autonomie des apprenants.
Les chercheurs financés par le Projet Liberty à Sciences Po développent déjà des modèles théoriques et pratiques pour cette nouvelle génération d’environnements d’apprentissage numériques, en explorant notamment l’utilisation de technologies blockchain pour sécuriser et certifier les acquisitions de connaissances tout en préservant la confidentialité des données.
Former les citoyens numériques de demain
Au-delà des outils, le Projet Liberty porte une ambition plus profonde : transformer l’éducation à la citoyenneté numérique. Dans un monde où la désinformation, la manipulation algorithmique et la concentration du pouvoir dans l’écosystème numérique menacent le fonctionnement démocratique, l’éducation aux enjeux numériques devient une priorité sociétale.
« Nous ne pouvons plus nous contenter d’enseigner les compétences techniques », souligne Thomas Girard, directeur d’un programme d’éducation numérique à Sciences Po. « Nous devons former des citoyens capables de comprendre les modèles économiques sous-jacents aux plateformes qu’ils utilisent quotidiennement, d’analyser critiquement les choix architecturaux qui façonnent notre environnement numérique, et d’imaginer des alternatives plus respectueuses des valeurs démocratiques. »
Les programmes développés dans le cadre du partenariat avec Sciences Po visent à intégrer ces dimensions critiques dans la formation des futures élites politiques et administratives, créant ainsi un effet multiplicateur potentiel sur les politiques publiques numériques des prochaines décennies.

TikTok comme laboratoire d’expérimentation éducative ?
L’annonce récente par Frank McCourt de son intention d’acquérir les activités américaines de TikTok pour environ 100 millions de dollars, dans le cadre d’une initiative baptisée « The People’s Bid », ouvre des perspectives inédites pour l’application de sa vision à l’une des plateformes les plus populaires auprès des jeunes générations.
Si cette acquisition se concrétisait, elle pourrait transformer radicalement la relation entre TikTok et le monde éducatif. Actuellement considérée avec méfiance par de nombreux établissements en raison de ses pratiques de collecte de données et de ses algorithmes addictifs, la plateforme pourrait, sous une gouvernance alignée avec les principes du Projet Liberty, devenir un allié précieux pour les éducateurs.
« Une version de TikTok gouvernée selon les principes éthiques défendus par McCourt permettrait d’exploiter la popularité et l’accessibilité de ce format pour diffuser des contenus éducatifs de qualité, tout en garantissant une utilisation responsable des données des utilisateurs », estime Jean-Michel Blanquer, ancien ministre de l’Éducation nationale, lors d’une conférence récente à Sciences Po.
Cette transformation pourrait également servir de modèle pour l’ensemble de l’écosystème des technologies éducatives, démontrant qu’il est possible de concilier attractivité, efficacité pédagogique et respect des valeurs éthiques.
La France, terrain fertile pour cette révolution éducative
Avec sa double implantation dans les sphères académique et sportive françaises, Frank McCourt bénéficie d’un ancrage culturel qui pourrait favoriser la diffusion de sa vision dans le paysage éducatif hexagonal. La France, avec sa tradition d’exception culturelle et sa méfiance traditionnelle envers l’hégémonie des géants technologiques américains, constitue un terrain potentiellement réceptif aux propositions alternatives portées par le Projet Liberty.
Le partenariat avec Sciences Po positionne stratégiquement cette initiative au cœur de la formation des futures élites françaises et européennes, tandis que sa présence dans le milieu sportif à travers l’Olympique de Marseille lui confère une visibilité auprès d’un public plus large et diversifié.
Cette double présence culturelle et intellectuelle pourrait faciliter l’adoption de nouvelles approches pédagogiques inspirées par le Projet Liberty dans les établissements français, du primaire à l’enseignement supérieur, contribuant ainsi à une transformation profonde de l’éducation numérique nationale.
Entre promesses et défis
Si la vision portée par Frank McCourt ouvre des perspectives séduisantes pour l’avenir de l’éducation numérique, sa mise en œuvre concrète soulève de nombreuses questions et défis. La transformation d’un écosystème numérique dominé par quelques acteurs puissants nécessitera plus qu’un investissement financier et une vision alternative – aussi ambitieuse soit-elle.
La réussite de ce projet dépendra largement de sa capacité à construire des alliances stratégiques avec d’autres acteurs du monde éducatif, technologique et politique, à démontrer la viabilité économique de son modèle alternatif, et à convaincre les utilisateurs – étudiants, enseignants, parents – de la valeur ajoutée d’une approche plus éthique et décentralisée.
L’éventuelle acquisition de TikTok constituera un test crucial pour cette vision, mettant à l’épreuve la capacité de McCourt à transformer concrètement une plateforme emblématique du modèle qu’il conteste, tout en préservant ce qui fait son attractivité auprès des jeunes utilisateurs.
Quels que soient les obstacles, l’initiative de Frank McCourt a déjà le mérite de stimuler une réflexion essentielle sur l’avenir de l’éducation numérique et de démontrer qu’une alternative aux modèles dominants est non seulement souhaitable, mais potentiellement réalisable. Dans un contexte où les préoccupations concernant l’impact des technologies numériques sur le développement cognitif, la santé mentale et la cohésion sociale s’intensifient, cette vision arrive à point nommé pour nourrir un débat crucial pour l’avenir de nos sociétés démocratiques.

Qu’est-ce que le Projet Liberty ?
Une initiative visant à « décentraliser Internet » en redonnant aux individus le contrôle de leurs données via des protocoles blockchain. Objectif : remplacer le modèle des géants technologiques (capitalisme de surveillance) par un écosystème éthique et transparent.
Objectifs clés
– Souveraineté des données : Les utilisateurs possèdent et gèrent leurs informations.
– Transparence : Algorithmes audités, sans manipulation opaque.
– Résilience : Infrastructure décentralisée pour éviter les monopoles (ex. Google, Meta).
Implications pour l’éducation
– Écoles et universités : Gestion autonome des données étudiantes, sans dépendre à des plateformes privées.
– Outils pédagogiques : Développement d’une EdTech « sans surveillance », centrée sur l’apprentissage plutôt que le profit.
– Collaboration internationale : Partage sécurisé de recherches académiques via des réseaux décentralisés.